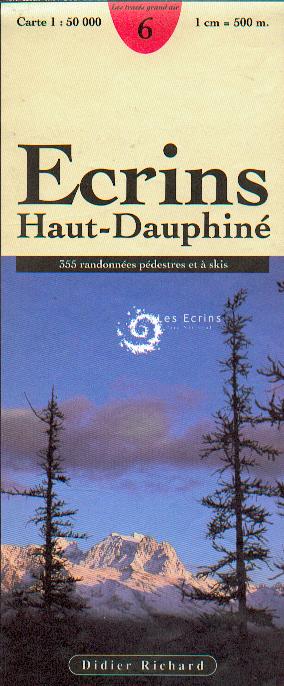 Depuis
1893 :
Depuis
1893 : Historique de la catothèque :
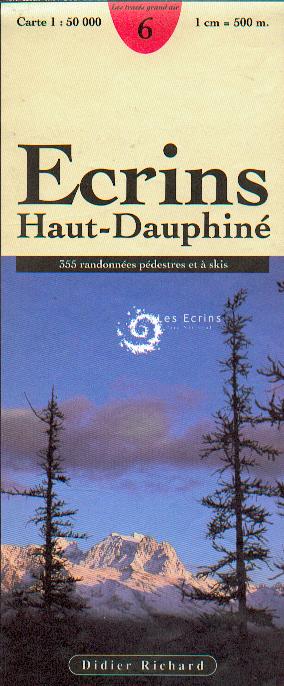 Depuis
1893 :
Depuis
1893 :
Il est difficile de dater exactement l’origine de la cartothèque du CAF d’Albertville. Les archives comptables n’existants pas, on ne peut connaître la date des achats. Un prix est imprimé sur les cartes les plus anciennes, parfois réactualisé par un timbre humide administratif. Ce pourrait être un indice. Mais on possède des «vieilleries» qui laissent à penser que, peu après la fondation du club en 1893, la cartothèque fut commencé.
Les cartes les plus anciennes sont du type 1889, dites « d’état major », à l’échelle 1/8000ème (1,25cm pour 1km). La représentation du sol en hachures, est imprimée en noir et blanc. Les hachures répondent à des définitions précises. Les graveurs essayent de restituer les mouvement du terrain pour donner une bonne vision du relief, pas forcément exacte, dissimulant parfois les imprécisions (1). L’impression des toponymes, également en noir, n’en facilite pas la lecture. Tout cela est un peu funèbre. Elles ont été publiées en 1895 par le service géographique des armées. Il en existe encore quatre, avec des marges manquantes, et aussi quelques « débris »:
Bonneville n° ?
Saint Jean de Maurienne n° ?
Tignes S.O n° 179
Tignes S.O n° 169 ter
Et une, coupé en deux sur le sud de la Chartreuse et le Granier, toutes éditées en 1897. Elles font parties de la carte générale de France levée entre 1818 et 1875; qui comprend 274 feuilles (1).
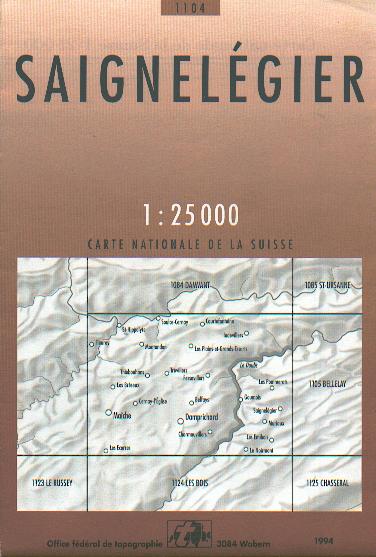 A
partir de 1889 elles seront agrandies photographiquement au 50000ème .
Cette carte en hachures restera en
service jusqu’en 1958 (1); c’est pourquoi dans la collection existent
quelques cartes publiés par l’institut géographique national (IGN), créé
en 1940 et publiées en 1941 et 1944. On peut penser qu’il était difficile de
trouver des cartes en couleurs, et que les libraires en profitaient pour
liquider leur stocks. La collection en renferme beaucoup, du type 1889, daté de
1907, 1921, 1938 et pour les dernières, révisées en 1931 et publiées en
1940, 1941 et 1944.
A
partir de 1889 elles seront agrandies photographiquement au 50000ème .
Cette carte en hachures restera en
service jusqu’en 1958 (1); c’est pourquoi dans la collection existent
quelques cartes publiés par l’institut géographique national (IGN), créé
en 1940 et publiées en 1941 et 1944. On peut penser qu’il était difficile de
trouver des cartes en couleurs, et que les libraires en profitaient pour
liquider leur stocks. La collection en renferme beaucoup, du type 1889, daté de
1907, 1921, 1938 et pour les dernières, révisées en 1931 et publiées en
1940, 1941 et 1944.
On ce servait aussi chez d’autres éditeurs et il existe quelques pièces intéressantes:
- Une
petite carte Vallot dans sa couverture orange: «environs de Chamonix» extraite
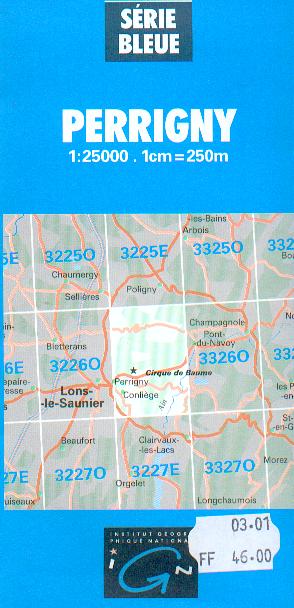 de
la carte du massif du Mont-Blanc (1907) en couleurs.
de
la carte du massif du Mont-Blanc (1907) en couleurs.
- Une série de trois cartes de France, «dressée par ordre du ministre de l’intérieur» à l’échelle 1/100000ème , en couleurs:
Feuille XXII 27 Voiron 1909
Feuille XXIV 27 Voiron Allevard 1910
Feuille XXIV 28 le Bourg d’Oisans 1910
- Une série sur la massif de la Chartreuse, publié avec le concours du Club Alpin Français et du Touring Club de France. Chez Andrieu, éditeur géographe, 21 rue du Bac à Paris. Echelle 1/20000ème en cinq couleurs.
2 Grand SomFeuille
3 Chamchaude Dent de CrollesFeuille
4 Lance de MalissardFeuille
5 Granier
la gravure de C. Buisson à Lyon (1918) sur la triangulation de Hellbronner.
- Une carte des aiguilles de Largentières, massif des Sept Laux. Levée et dessin de r. Du Verger (bleu, violet, marron, noir). Une petite merveille à la gravure superbe.
-Une carte à l’échelle approximative au 1/50000ème (la réalisation l’est tout autant). Allevard, Le Curtillard, les Sept Laux par le commandant Boell et Albert Ferrgier, secrétaire du ski club allevardin, 3ème édition, sans date, en couleurs et sans courbe de niveau.
- Six topo guide sur le massif de la Chartreuse au 30000ème décrivant des randonnées:
1 Charmant Som, Pinéa
2 la Grande Sure
3 le Grand Som O
4 le Grand Som E
5 la Dent de Crolles
6 Chamchaude
Les cartes étaient probablement à la disposition des membres et pourraient donner une indiction sur les massifs fréquentés au début du XXème siècle.
Après la grande guerre aux années 60 :
Ceci
nous conduit après la grande-guerre, et les achats semble se limiter aux cartes
en couleurs. Elles sont au 50000ème, du type 1922 publiées par le
service géographique des armées, et plus tard par l’institut géographique
national. Celles que nous possédons sont datées de: 1926, 1928 et 1931. Les
plus récentes datent de 1953, 1954… Les acheteurs semblent avoir des préférences,
avec ou sans carroyage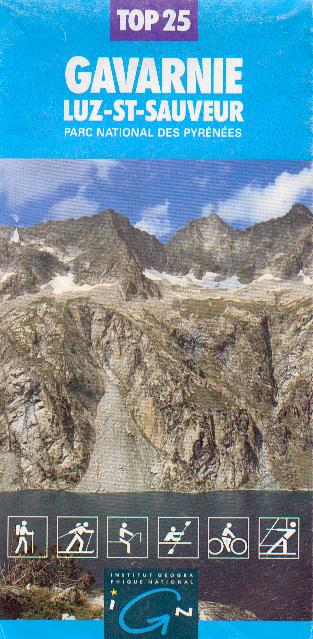 Lambert. On remarque deux colories, des cartes à dominante bistre ou marron
clair, d’un aspect rébarbatif; des cartes avec le fond des ombre gris.
Lambert. On remarque deux colories, des cartes à dominante bistre ou marron
clair, d’un aspect rébarbatif; des cartes avec le fond des ombre gris.
Qu’achetait-on? Les cartes des massifs fréquentés bien sur! Probablement les plus demandées: Mont-Blanc, Oisans, Arves, les cartes de la chaîne frontière et celles de la région albertvilloise; 37 cartes en tout. Il y avait une véritable passion pour les plans directeurs au 20000ème . Cette échelle devaient plaire aux alpinistes. Ils sont: clairs, lisibles, précis et permettent une bonne appréciation du relief. Les rochers et parois sont gravés avec finesse par un burin très sur, mais le sommet convoité et souvent dans un angle et plusieurs cartes sont alors nécessaires. Cette série est constituée par un ensemble de cartes type 1922, au 50000ème présentant un découpage, soit en 8 feuilles au 20000ème numérotées de 1 à 8, soit en 4 feuilles, numérotées: 1.2 / 3.4 / 5.6 / 7.8 . Si l’on récapitule suivant en suivant le découpage général de la France en colonnes d’ouest en est, 02 à 39 et en rangs du nord au sud, 02 à 50. On compte:
col XXXI. 1 feuille. Charpey. 36
col XXXII. 6 f. De la Tour du Pin 32 à Mens 37
col XXXIII. 8 f. De Seyssel 30 à St Bonnet 37
col XXXIV. 10 f. De Douvaine 28 à Orcières 37
col XXXV. 9 f. de Thonon 28 à Guillestre 37
col XXXVI. 8 f. de Pas de Morgens à Aiguilles 37
Soit au
total 43 feuilles au 50000ème qui se découpent en 45 feuilles au
25000ème et 219 au 20000ème
. Il y a quelques trous. Cette série a été reconstitué grâce
à Jacques Husson. Le travail de classification, le répertoire et les fiches
sont une 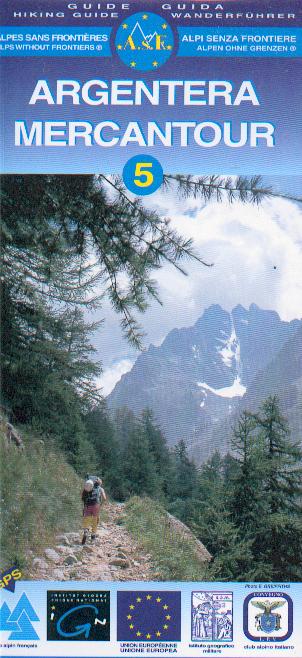 réalisation
d’Albert Reydet. Voici un ensemble précieux car l’IGN en a suspendu le
tirage. Cela évite les mises à jour. Elles servent encore aujourd’hui pour
affiner les itinéraires.
réalisation
d’Albert Reydet. Voici un ensemble précieux car l’IGN en a suspendu le
tirage. Cela évite les mises à jour. Elles servent encore aujourd’hui pour
affiner les itinéraires.
Notons aussi quatre très belles cartes au 10000ème, magnifiquement coloriées, hélas un peu ternies. La série est incomplète et comprend: Aiguille verte (Chamonix n°6 sud); Aiguille du Midi ( Mt-Blanc n°1 nord); Chamonix Mt Blanc (Chamonix n°5 sud); la Flégère (Chamonix n°5 nord). La beauté de la gravure, la sûreté du trait, la précision de l’encrage en font une véritable œuvre d’art.
(1) = Encyclopaedia Universalis